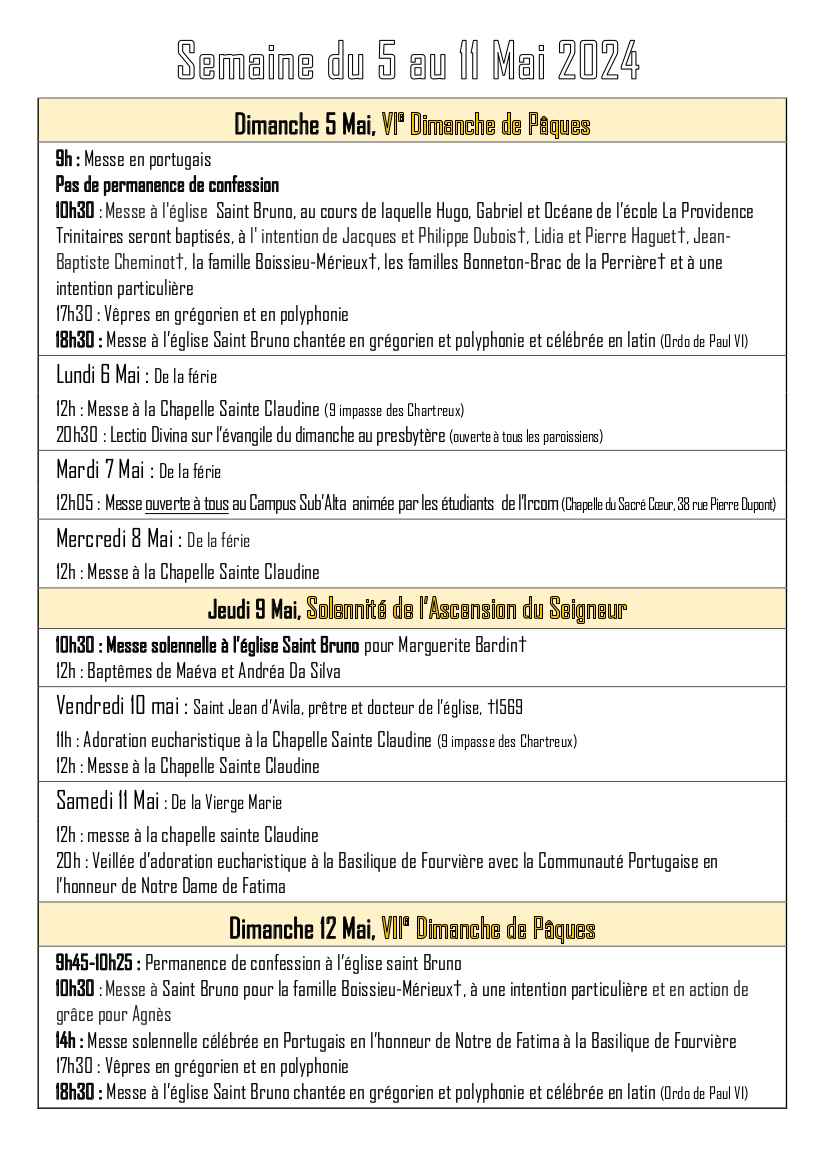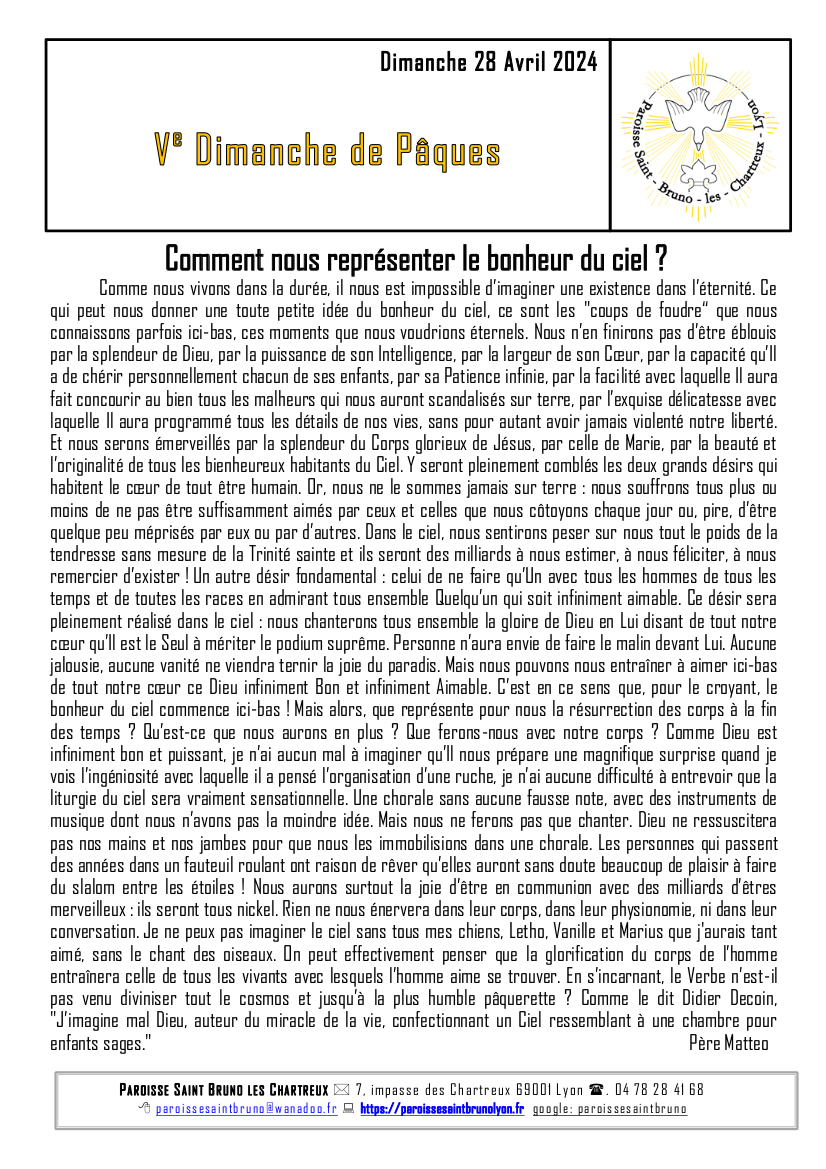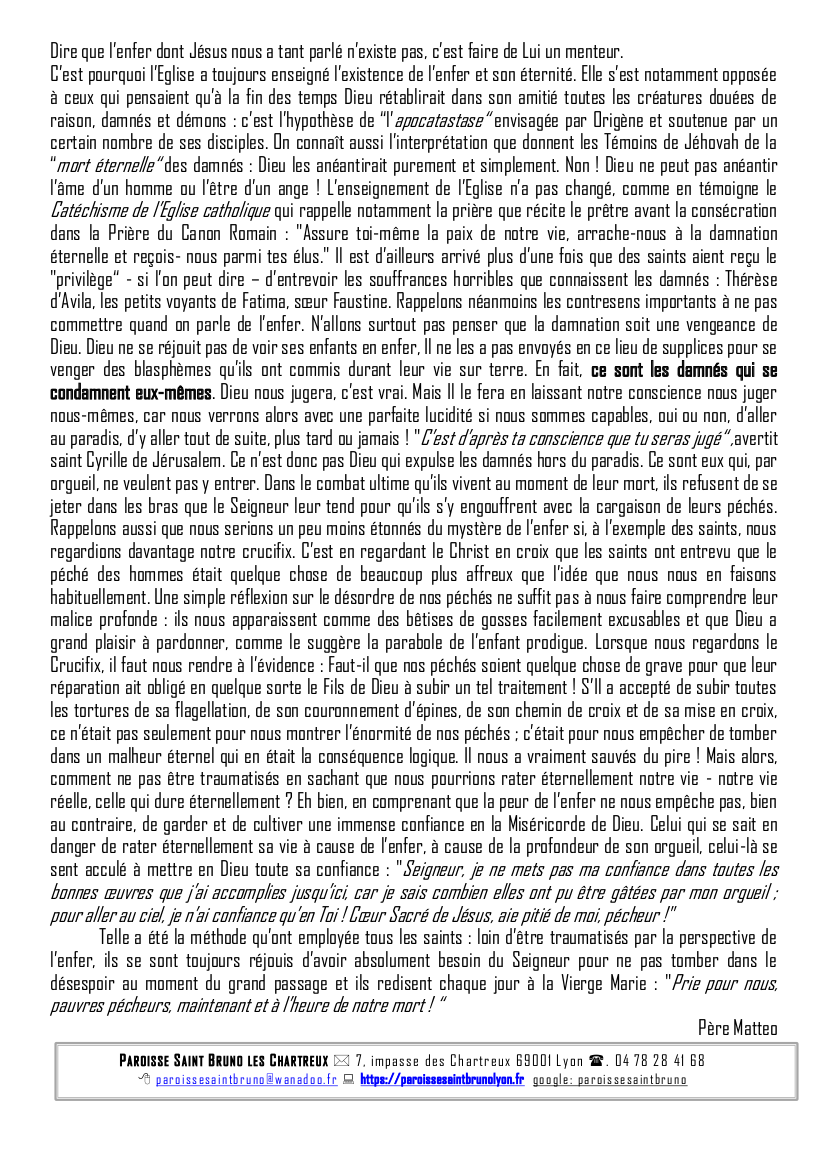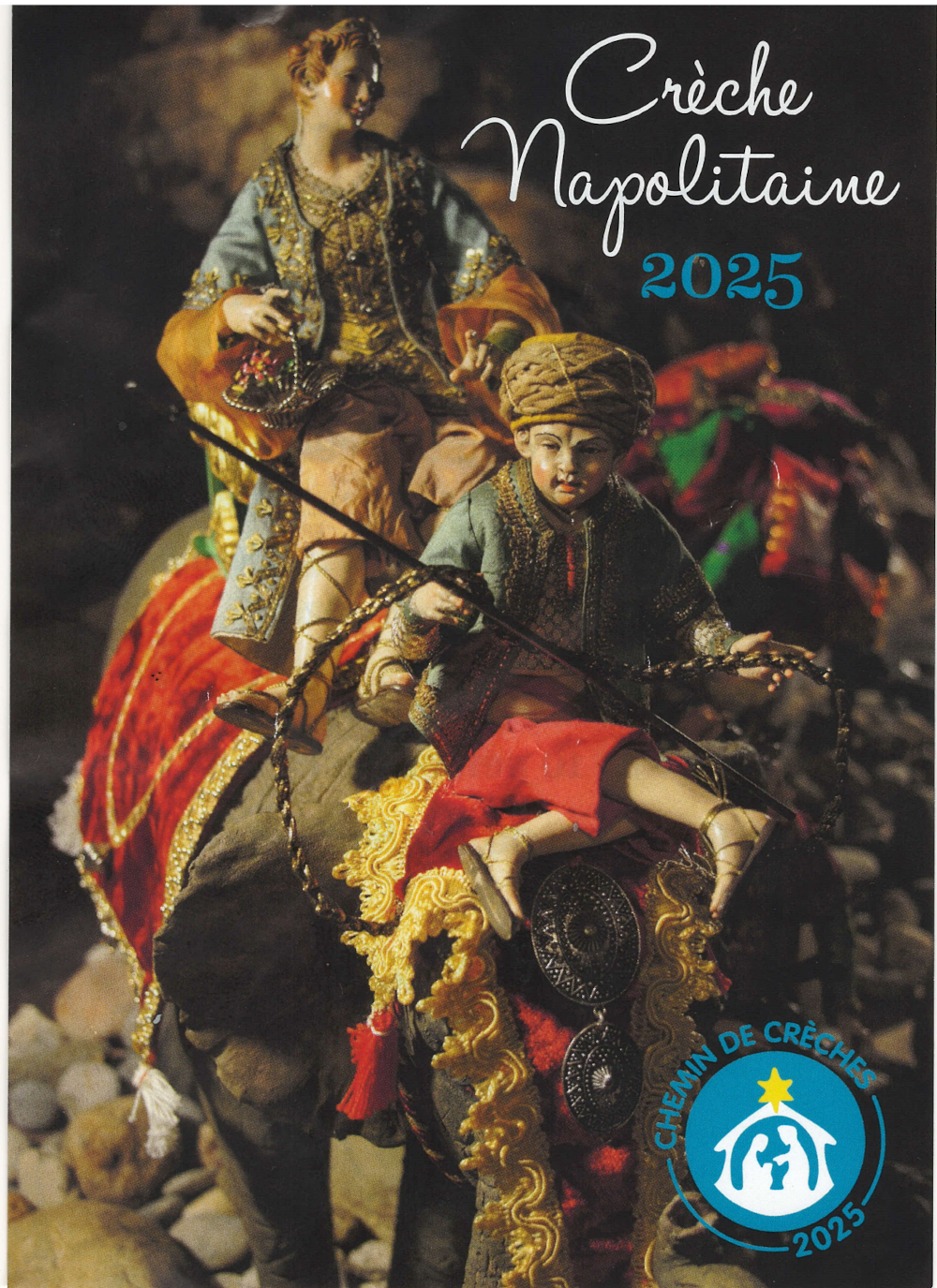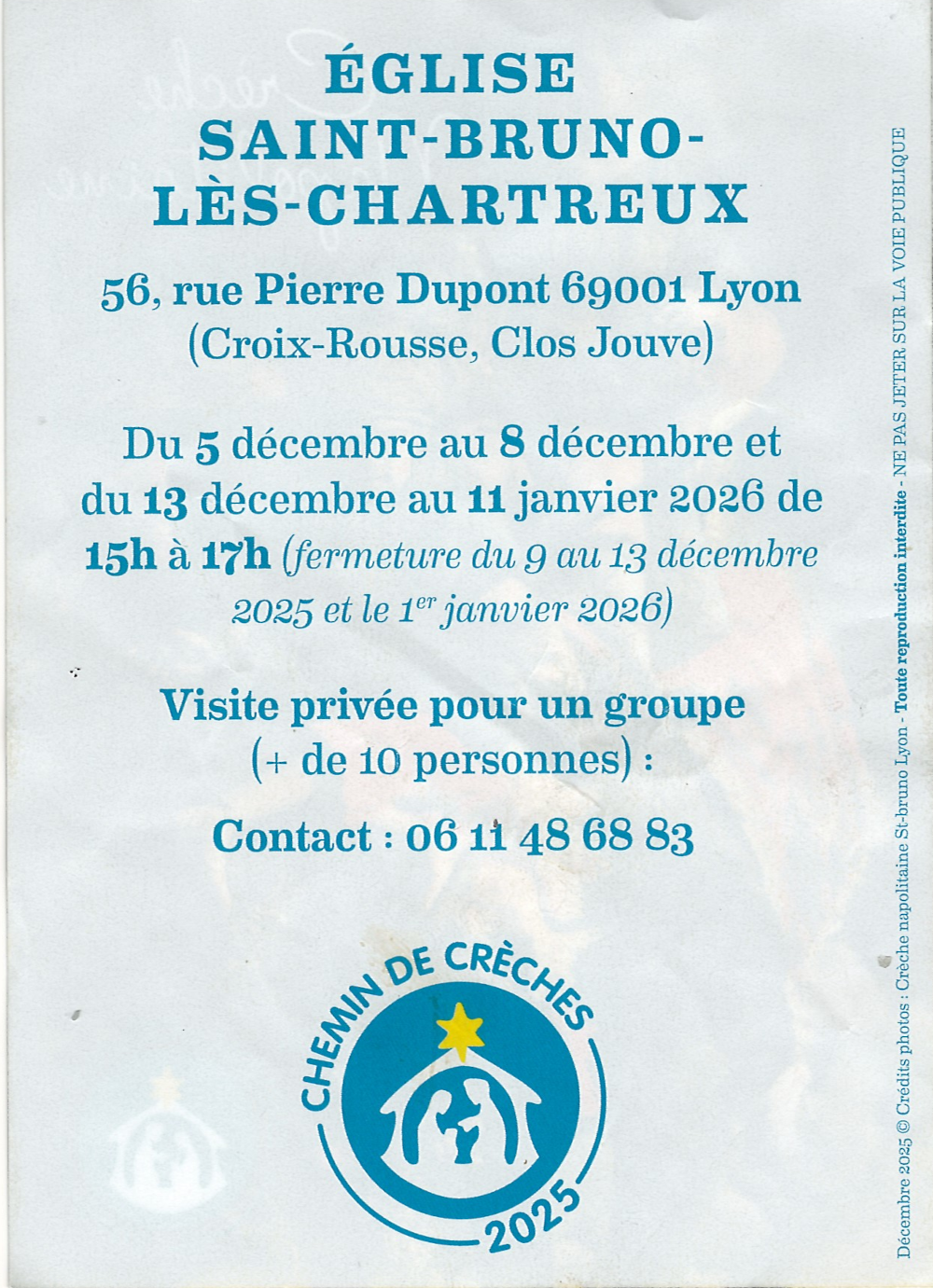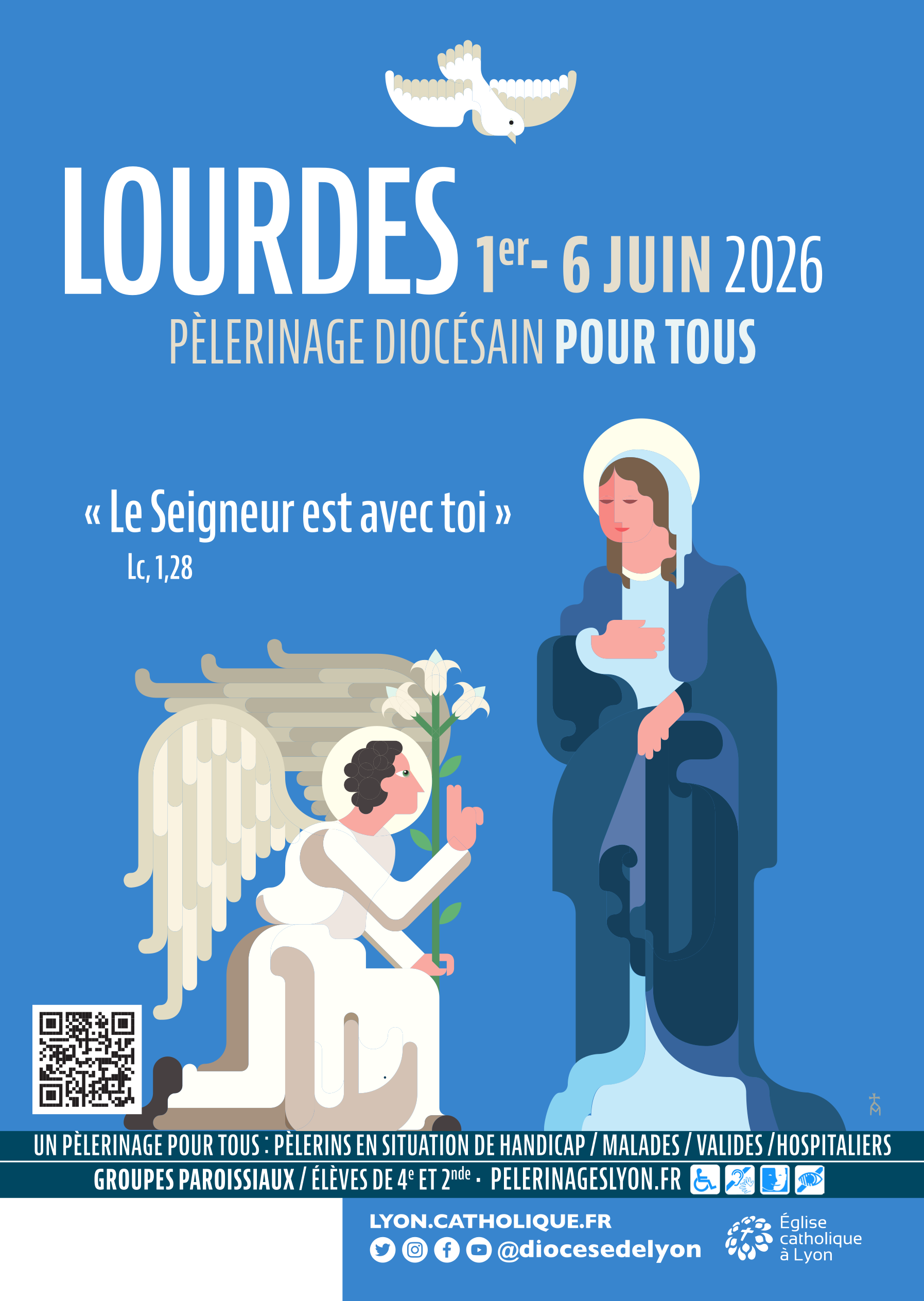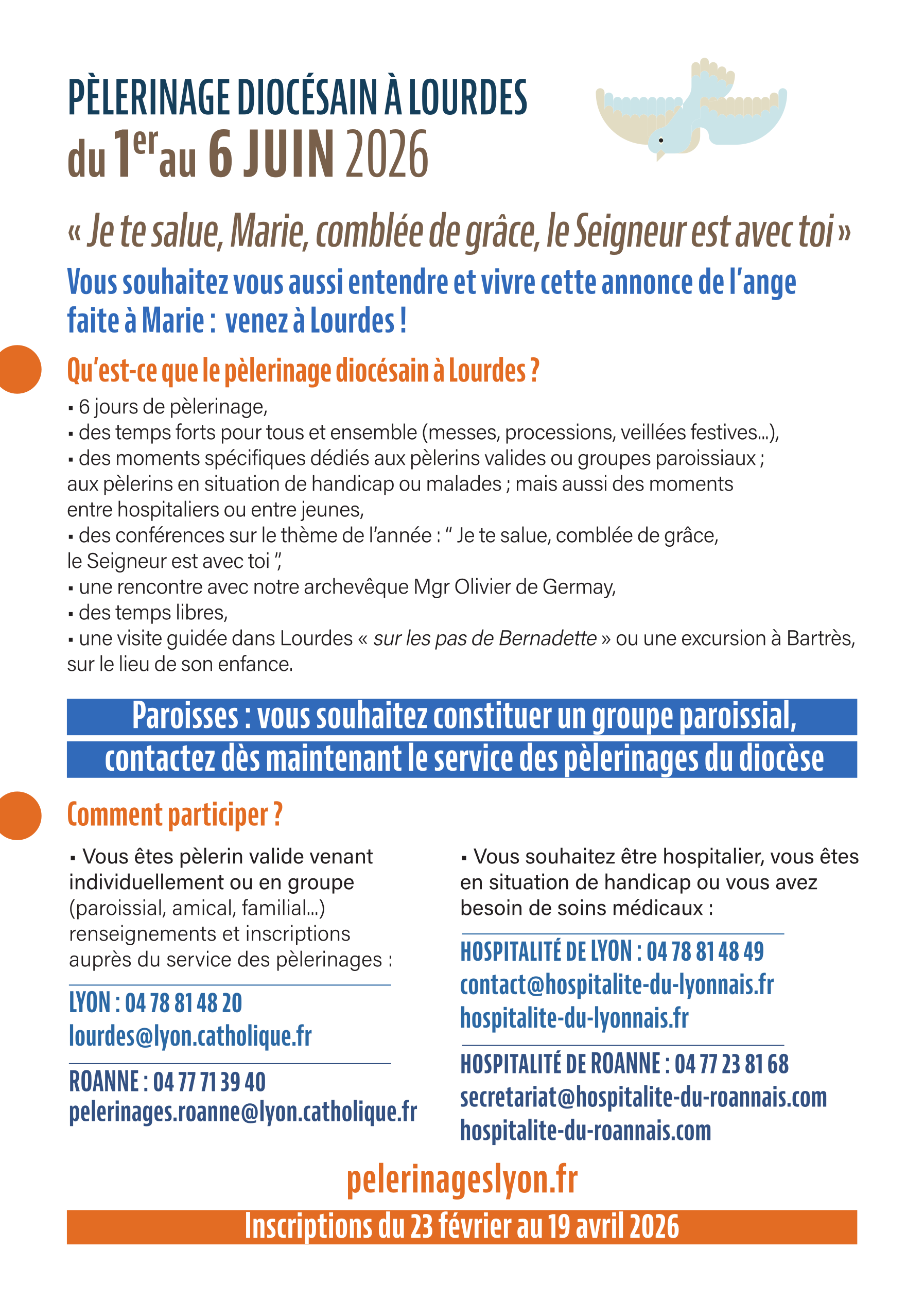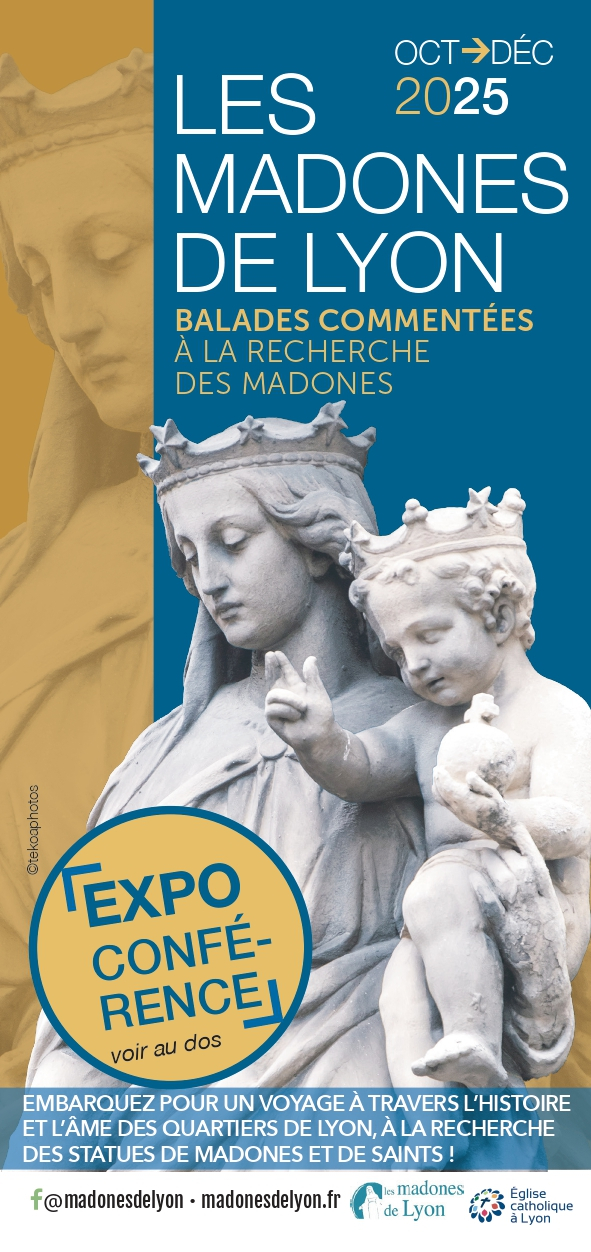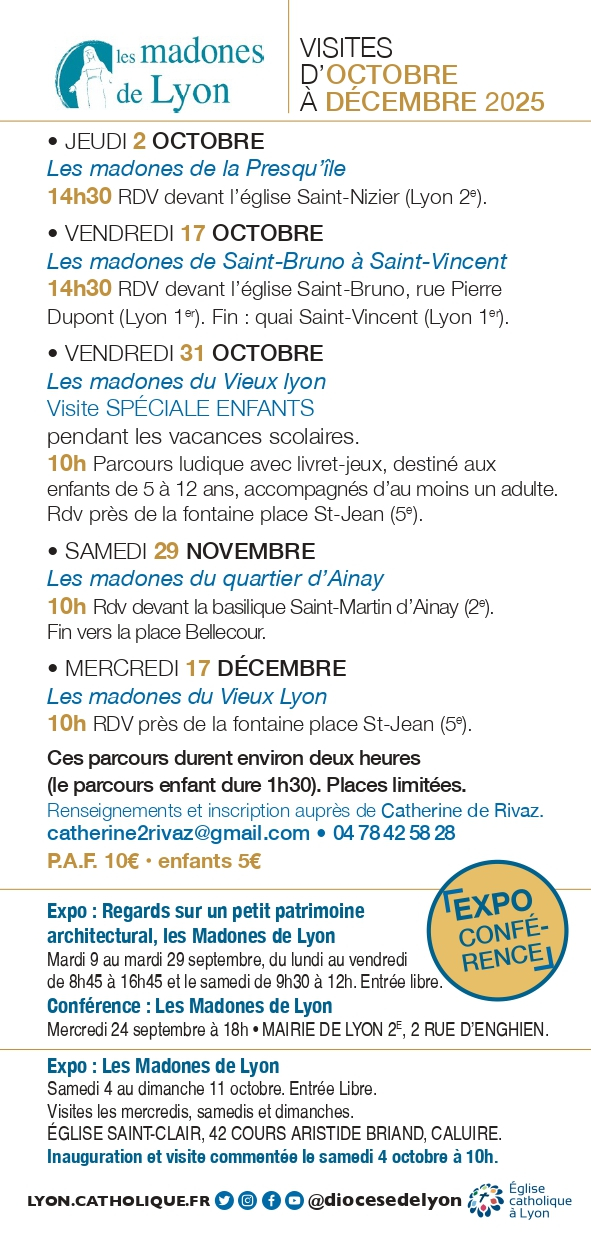§Chapitre VII
Lutte de l'Église contre les mauvaises passions des rois.
Concile de Poitiers rassemblé pour condamner le roi de France. — Héroïsme de Bernard, abbé de saint Cyprien, de Robert d'Abrissel et du légat Jean. — Repentir et pénitence du duc d'Aquitaine. — Énergie indomptable d'Yves de Chartres. — Sa franchise hardie dans ses relations avec le pape. — Modération et fermeté d'Yves de Chartres dans la lutte entre les deux pouvoirs. — Il osait faire des représentations au pape. — Ce que devinrent Jérusalem et les Croisés après la mort de Godefroy de Bouillon. — Bohémond, prince d'Antioche, épouse la fille du roi de France et prêche la Croisade à N.-D. de Chartres, puis en Espagne et en Italie. — Concile de Poitiers où le moine Bruno et Bohémond, prince d'Antioche, prêchent la Croisade. — Influence des moines de la Grande-Sauve sur la chevalerie d'Espagne.
pp. 316-319
On a vu, pendant l'exil d'Anselme, quelle vive sympathie le roi Philippe de France témoignait au pontife persécuté. Il serait difficile de déterminer dans quelle mesure se mêlait à la sympathie royale le sentiment jaloux que devait naturellement inspirer au monarque français la position d'un prince qui, étant à la fois son rival comme roi d'Angleterre et possesseur du duché de Normandie, sur le continent, était beaucoup plus puissant que son suzerain. Toutefois, avant d'offrir un asile au primat défenseur et victime de la liberté de l'Église », Philippe avait dû se courber lui-même sous la verge maternelle de cette Église. On se rappelle comment, emporté par sa passion pour la comtesse d'Anjou, le roi de France, d'abord excommunié au concile de Clermont, puis absous après s'être séparé de sa maîtresse, était retombé dans l'adultère public ; on n'a pas oublié avec quelle énergie Yves de Chartres avait dénoncé le scandale. Dès son avènement, Pascal II avait en effet chargé deux cardinaux légats, Jean et Benoît, d'aller juger de nouveau cette grande cause. Yves félicita tout d'abord l'un des prélats de s'être abstenu de toute communion avec le roi, à la différence d'autres évêques qui n'avaient pas craint de le couronner, depuis la mort du pape Urbain II, comme si la justice était morte avec celui qui devait en être le héraut [317-1].
Concile de Poitiers rassemblé pour condamner le roi de France.
D'accord avec Yves, les prélats convoquèrent un concile à Poitiers, afin de siéger hors des contrées directement soumises au roi, et où l'on n'aurait pu sans scandale faire entendre certaines dépositions des témoins [317-2]. Le concile se célébra à l'octave de la Saint-Martin de l'an 1100, en présence d'un grand nombre d'évêques et d'abbés [318-1]. Après la déposition de l'évêque d'Autun, convaincu de simonie, et après avoir réglé diverses affaires, on en vint à celle du roi. Philippe avait conjuré le duc Guillaume d'Aquitaine, comte de Poitou, d'empêcher, à tout prix, qu'on prononçât l'excommunication contre lui dans une ville qui relevait de son autorité [318-2]. Or, Guillaume devait être d'autant plus porté à se rendre au vœu du prince, que sa propre conduite était encore plus scandaleuse que celle de son suzerain, et qu'il devait craindre un châtiment analogue [318-3]. Le légat Jean comprenait tout le danger d'une telle situation ; chaque soir, on le voyait agenouillé et priant, dans l'église de saint Hilaire, le grand évêque qui avait si noblement tenu tête à un empereur arien. La veille du grand jour, Jean avait conjuré, avec larmes, l'illustre patron de l'Église de Poitiers de lui venir en aide dans la lutte du lendemain. Or au moment où il s'endormait en priant avec ardeur, saint Hilaire lui était apparu et avait promis de l'assister et de le faire triompher de tous les ennemis de la foi [319-1].
Cependant, le jour d'après, tandis qu'on lisait les actes du procès, on vit tout à coup le comte de Poitiers entrer dans le concile, entouré d'une bande de soldats furieux comme lui [319-2], et qui, interrompant la lecture, dit à haute voix : « Le roi mon seigneur m'a mandé que vous vouliez l'excommunier, à sa honte et à la mienne, dans cette ville que je tiens de lui [319-3]. Il m'a donc ordonné de ne pas le souffrir, en raison de la féauté que je lui dois, et je viens vous défendre d'entreprendre rien de pareil. »
pp. 319-321
Comme le comte joignait à ces paroles la menace de faire main basse sur tous ceux qui désobéiraient , plusieurs prélats se rangèrent de son côté [319-4] ; tout le monde était effrayé, surtout les évêques et les abbés du domaine royal [320-1], qui s'échappèrent de l'assemblée, suivis par beaucoup d'autres assistants [320-2].
Rare courage de Bernard abbé de Saint-Cyprien, de R. d'Arbrissel et du légat.
Mais, dans le désarroi, deux religieux, Bernard, qui venait d'être élu abbé de Saint-Cyprien, à Poitiers même, et Robert d'Arbrissel, le futur fondateur de Fontevrault, restèrent impassibles au milieu de tous les dangers [320-3]. Le légat Jean, ancien moine de Pavie [320-4], le légat, plus intrépide que nul autre, arrêta les pères, en s'écriant : « Quand le seigneur comte se montre si fidèle aux ordres de son roi temporel, combien plus ne devons-nous pas, nous, obéir aux ordres du Roi céleste, dont nous sommes les vicaires ! Que les mercenaires s'effrayent et s'enfuient devant le loup ; mais que les bons et vrais pasteurs restent ici, avec nous, et sachent endurer la persécution pour la justice [320-5]. » Puis, se retournant vers le comte, Jean lui dit à haute voix : « Le bienheureux Jean-Baptiste a eu la tête coupée par Hérode, dans des circonstances analogues ; moi aussi, je suis prêt à laisser trancher la mienne par toi, si cela te convient. » Puis, tendant le cou : « Frappe, si tu l'oses, dit-il, je suis prêt à mourir pour la vérité [321-1]. »
Le duc Guillaume vivait en un temps où le courage d'un prêtre était compris et où quelque « lumière venait toujours d'en haut »; il se reconnut donc vaincu, et sortit à la hâte de l'église pour ne pas assister à l'excommunication de son suzerain [321-2].
Le légat reprit alors la parole et dit aux Pères : « Ne craignez point les menaces du prince, car son cœur est entre les mains de Dieu, qui ne permettra pas qu'on sévisse contre aucun de vous rassemblés ici en son nom. D'ailleurs, sachez que nous avons pour appui, dans cette lutte, le B. Hilaire, patron de la ville. Cette nuit même, le saint m'est apparu, et il m'a annoncé qu'il combattrait avec nous et que nous triompherions [321-3]. »
pp. 321-322
Ces paroles ramenèrent la paix et la confiance ; on apporta des cierges allumés, pour les éteindre au moment où serait prononcée la sentence d'excommunication, qui fut promulguée, sans autre opposition, contre le roi et contre Bertrade. Mais la démarche du duc avait excité les esprits contre le concile : la foule s'était amassée et le tumulte augmentait toujours. Au milieu des acclamations par lesquelles se terminent de pareilles assemblées, un homme du peuple, qui se tenait aux galeries supérieures de l'église, lança contre les cardinaux-légats une pierre qui ne les atteignit point, mais qui alla casser la tête à un clerc de leur suite. La vue du sang versé dans l'église augmenta l'excitation et le tumulte. Alors, les deux légats, ôtant leurs mitres, restèrent tète nue afin de montrer qu'ils ne craignaient ni les pierres qu'on pourrait encore leur lancer, ni la mort sous quelque forme qu'elle leur vînt [322-1].
Repentir et pénitence du duc d'Aquitaine.
Tant de calme et de courage finirent par désarmer les fureurs de la foule, et bientôt on vit le duc lui-même venir confesser sa faute. Prosterné devant les cardinaux, il leur demanda pardon, et jura de ne plus enfreindre la liberté de l'Église à l'avenir [322-2]. L'année suivante, en effet, il partit pour la croisade où se rendait aussi Eudes, ce duc de Bourgogne que le regard de saint Anselme avait arrêté dans sa violence, vaincu dans sa révolte contre les lois divines, et poussé vers la croisade, comme le duc d'Aquitaine, par l'irrésistible ascendant du génie catholique.
pp. 322-324
Quant au roi Philippe, la terrible sentence produisit sur lui l'effet accoutumé ; elle lui fit comprendre qu'il ne comptait plus dans l'Église. Étant venu peu après à Sens, avec Bertrade, toutes les églises se fermèrent pendant les quinze jours qu'ils y passèrent. Bertrade, irritée, envoya briser la porte d'une des chapelles où la messe devait être dite par un prêtre qui avait eu la lâcheté d'obéir [323-1]. Philippe furieux, fit publier qu'il irait à Rome, et qu'il saurait bien obtenir du pape l'absolution de la sentence dont les légats l'avaient frappé, comme cela s'était déjà fait sous Urbain II. Mais Yves de Chartres crut devoir prévenir le pape de ce qui se tramait : « Soit qu'il vienne, soit qu'il envoie, écrivit-il à Pascal, ayez soin, pour vous et pour nous, de le serrer ferme sous les chaînes et les clefs de saint Pierre [323-2]. Que si, après avoir été absous, il retournait à son vomissement, comme cela lui est arrivé déjà, que tout de suite il soit renfermé sous les mêmes clefs, lié par les mêmes chaînes, et qu'il en soit donné connaissance, par des lettres de votre main, à toutes les Églises. C'est ainsi seulement que vous échapperez à la dent des critiques, et que vous satisferez à la justice. Mais si, par hasard, Dieu ramenait son cœur au repentir, souvenez-vous de nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur, et faites-nous part de la consolation, puisque nous avons eu une si grande part à la tribulation [324-1]. »
pp. 324-325
Philippe ne mit point sa menace à exécution ; mais, vers le même temps, Yves dut s'élever contre un nouveau scandale du fait de ce prince. L'Église de Beauvais étant devenue vacante, on y avait élu pour évêque, à la recommandation du roi et de Bertrade [324-2], un clerc de grande naissance, Étienne de Garlande, qui était fils du sénéchal de France, et autrefois avait été chassé de l'Église par l'archevêque de Lyon, par suite d'un adultère public. Yves, plein d'une tendre sollicitude pour l'Église de Beauvais, dont il était sorti, dénonça aux légats Jean et Benoît, puis au pape lui-même, cette élection scandaleuse [324-3]. Elle fut cassée à Rome, et la partie saine du chapitre, de l'avis des seigneurs du diocèse, élut, avec le consentement du peuple, un religieux nommé Galon, de naissance obscure, mais qui, outre qu'il était très instruit et le disciple d'Yves, menait la vie la plus exemplaire [324-4]. Les autres chanoines, gagnés par les présents de Garlande, protestèrent contre l'élection et dénoncèrenl Galon au roi comme un élève d'Yves de Chartres et une créature du pape. Philippe et le jeune roi Louis [325-1] jurèrent que jamais ils ne le reconnaîtraient pour évêque de Beauvais :
Énergie indomptable de Yves de Chartres.
« Si un tel serment, écrivait Yves au pape, pouvait annuler une élection canonique, il n'y aurait plus désormais en France d'autre élection que des intrusions par violence ou par simonie [325-2]. » L'évêque prit donc avec chaleur le parti de Galon, tant auprès du souverain pontife que de l'archevêque de Reims, et, se justifiant des objections qu'on faisait contre l'humble naissance de son protégé, « s'il plaît à Dieu, dit-il, de choisir, selon son usage, les humbles et les faibles pour confondre les forts, qui osera lui résister ? David n'était-il pas berger avant d'être roi, et Pierre pécheur avant d'être prince des apôtres ? Dieu tire sans cesse les pauvres de la poussière et les place au faîte des grandeurs, pour montrer qu'il n'a souci ni de la puissance ni de la sagesse d'ici-bas [325-3]. »
pp. 325-326
Saint Anselme écrivit aussi à Pascal [325-4] en faveur de l'élu de Beauvais, qui, tenu éloigné de son diocèse par l'obstination du roi, alla chercher à Rome l'asile que devait lui garantir l'affectueuse protection du primat d'Angleterre et du plus zélé des évêques de France. Le pape l'employa avec fruit comme légat en Pologne [326-1]. À son retour à Rome, et quoique absent de France, il fut nommé évêque de Paris, par le clergé et par le peuple, tout d'une voix. Le roi ne s'opposa point à cette translation, et, de son côté, Galon obtint du pape qu'il consentît à absoudre le roi, sous certaines conditions. Yves lui-même, au bout de quelque temps, réclama pour la faiblesse du prince tous les tempéraments qui pouvaient être compatibles avec le salut de son âme [326-2]. Un nouveau légat fut envoyé, et, après deux conciles tenus à Troyes ( 2 avril 1104 ) et à Beaugency ( 30 juillet ), le roi fut définitivement absous à Paris, le 2 décembre 1104, selon les règles prescrites par le pape.
pp. 326-327
En présence d'Yves, de Galon, de huit autres évêques, et d'une foule de clercs et de laïques, Philippe vint, pieds nus, avec tout l'extérieur de l'humilité et de la dévotion, jurer sur l'Évangile de renoncer à ses relations illicites avec Bertrade, et de ne plus la voir qu'en présence de témoins non suspects. Bertrade fit le même serment. Tous deux furent alors réconciliés avec leur mère l'Église par le saint prélat Lambert, évêque d'Arras, chargé par le pape de le représenter [327-1].
pp. 327-329
Yves se faisait remarquer dans toutes les contestations, comme dans l'administration générale des affaires de conscience, par son zèle pour la discipline et le bien des âmes. Consulté de tous les côtés, il était considéré comme la lumière et l'oracle de l'Église de France ; ses réponses se distinguaient par le double caractère de la sagesse et de la justice [327-2]. Il réprouvait l'usage des combats judiciaires [327-3], poursuivait avec ardeur la réforme des abus dans les monastères comme dans toute l'Église [327-4], et montrait surtout, dans toutes les affaires relatives à la pureté et à la liberté des mariages, une persévérante sollicitude pour les droits des femmes et le maintien des prohibitions ecclésiastiques à l'endroit des alliances trop rapprochées [327-5].
Franchise d'Yves de Chartres dans ses relations avec le souverain pontife.
Quoiqu'il fût le plus ferme appui des papes légitimes, et, parmi les évêques de France, le plus dévoué au saint-siége, on remarque, dans toute sa correspondance avec les souverains pontifes, une énergique franchise et la liberté la plus complète. Il ne leur épargnait ni les conseils ni les remontrances. Il recommandait, par exemple, au pape Pascal de dominer par la vertu aussi bien que par l'autorité [328-1]. « Ma conscience, lui écrivait-il, me dit que je suis le vrai fils sorti des entrailles mêmes de l'Église romaine ; ses scandales me brûlent ; ses tribulations sont les miennes, et les mauvaises langues qui la déchirent me brisent le cœur [328-2]. » Il s'armait de cet amour filial pour reprocher au pape sa tolérance à l'égard de certains légats à esprit superficiel [328-3] ; pour blâmer les appels trop fréquents [328-4] ; pour réclamer contre la crédulité avec laquelle on accueillait à Rome les calomniateurs du clergé, et contre la protection qu'on y accordait à des rebelles [328-5] ; pour critiquer avec sévérité la vénalité des camériers et autres ofliciers inférieurs de la cour romaine, lesquels prélevaient des droits sous tous les prétextes et jusque sur les plumes et le papier [329-1]. « Je ne sais comment répondre à ces récriminations, ajoutait le prélat, si ce n'est en citant cette parole de l'Évangile : Faites ce qu'ils disent et non ce qu'ils font [329-2]. » Il laissait voir que le silence des honnêtes gens sur ces sujets de scandale lui semblait une véritable prévarication. « Si la honte de mon père, disait-il, est de nouveau découverte, ce qu'à Dieu ne plaise, nous ne nous en moquerons pas, comme des fils de perdition, mais nous cesserons de donner des avis inutiles. Que Votre Sainteté ne s'indigne pas de ce que je lui parle ainsi, comme un fils à son père, car il est beaucoup d'amis de la justice qui, s'apercevant qu'on a pardonné ou dissimulé trop de crimes, en arrivent à prendre le parti du silence, par désespoir [329-3]. »
p. 330
Tout en réclamant sans cesse la rigueur des lois ecclésiastiques contre les prévaricateurs, de quelque condition qu'ils fussent, Yves voulait que toutes les procédures fussent conduites avec la plus stricte observation des formes et des droits, en faveur de l'accusé. Déjà saint Grégoire VII avait flétri l'abus des excommunications extrajudiciaires, en répétant à l'évêque de Prague les paroles de saint Grégoire le Grand : « Celui qui lie des innocents souille entre ses mains le pouvoir de lier et de délier [330-1]. »
pp. 330-331
Lorsque Rotrou, comte du Perche, qui avait envahi les terres d'un chevalier engagé dans la croisade [330-2] et, par conséquent, placé sous la protection du siège apostolique, se fut attiré l'excommunication que, par l'ordre du pape, l'archevêque de Sens avait fulminée contre lui, Yves, qui était l'un des suffragants du prélat, s'opposa avec persévérance à ce que la sentence fut promulguée avant que le comte eût fait entendre sa défense : « Je ne veux pas, disait-il, frapper quelqu'un sans l'entendre, à la façon des assassins ; je ne veux pas livrer à Satan celui qui ne veut ni se dérober à la justice ni la mépriser [330-3]. » Il apportait la même conscience à l'octroi des absolutions aux pécheurs publics : « Si j'étais forcé, écrivait-il à son métropolitain, d'admettre à la réconciliation un impénitent, je lui dirais publiquement : Voici le seuil de l'Église visible, je te permets de le franchir, à tes risques et périls ; mais je ne puis t'ouvrir ainsi la porte du royaume des cieux [331-1]. »
Modération sans faiblesse de Yves de Chartres dans la lutte entre les deux pouvoirs. pp. 331-334
Ses actes dans la grande lutte de son siècle entre les deux pouvoirs furent toujours remarquables par leur modération. Quoique la nécessité de la défense l'ait condamné à être, pendant la plus grande partie du pontificat d'Urbain II, en guerre ouverte contre le prince dont il avait dénoncé les désordres et qui l'avait mis en prison pour se venger, il n'en avait pas moins conservé un affectueux respect pour la royauté française si dévouée au saint-siége. Mais, s'étant lui-même soumis à l'investiture royale, il lui répugnait de déclarer, avec Grégoire de sainte mémoire [331-2] que l'usage constituait une hérésie au même titre que la simonie [331-3]. Cependant, il finit par admettre et proclamer formellement, sur ce point, la doctrine de Grégoire et d'Urbain [331-4]. Mais il eût désiré servir de médiateur entre les deux forces rivales, et concilier, par la prudence, par l'indulgence, par tous les tempéraments permis, leurs droits réciproques. « Quand la royauté et le sacerdoce sont d'accord, écrivait-il au pape, le monde marche mieux et l'Église fleurit et fructifie ; mais, lorsque la discorde les sépare, ce qui est faible ne peut plus se fortifier et la plus grande force est détruite [332-1] » Mais cet esprit de conciliation n'altérait en rien, chez lui, la foi au droit, à la puissance, à la suprématie de l'Église, ni son courageux attachement à l'inviolable légitimité des droits de l'Église sur les âmes et sur elle-même : « Que Dieu ait d'abord, dans son Église, par un droit supérieur ( principaliter ), ce qui lui appartient, et qu'après cela ( posteriori ordine ) le roi obtienne ce qui lui est concédé par Dieu [332-2]. » Telle était son interprétation du texte : Rendez à César. Il écrivait au comte de Meulan, principal ministre du roi Henri d'Angleterre : « Si la puissance royale entreprend quelque chose contre le Christ et son Église, tu dois te rappeler que tu as été racheté par le sang de ce Christ, initié ( initiatus ) aux lois de ce Christ, régénéré par les sacrements de l'Église ; que tu es l'affranchi de Celui qui s'est fait serf pour toi, et que tu ne dois aucune espèce de soumission à qui voudrait offenser la majesté divine ou restreindre la liberté de l'Église… Les rois sont faits pour punir les violateurs des lois, et non pour les violer eux-mêmes [333-1]. » Au roi lui-même, l'archevêque écrivait en ces termes, pour le féliciter de son avènement : « Nous invitons Votre Altesse à laisser un libre cours à la parole de Dieu dans le royaume qui vous est confié, et à toujours songer que cette royauté terrestre est soumise à la royauté céleste, confiée à l'Église. Comme les sens sont soumis à la raison et le corps à l'âme, ainsi la puissance terrestre doit être soumise au pouvoir ecclésiastique…. Et, comme le corps n'est tranquille que lorsque la chair ne résiste pas à l'esprit, ainsi le royaume de ce monde n'est paisible que lorsqu'il cesse de résister au royaume de Dieu. Pensez à cela et comprenez que vous êtes non pas le seigneur, mais le serviteur des serviteurs de Dieu, et que vous devez être un de ces cèdres du Liban, que le Seigneur a plantés pour que les oiseaux du ciel y trouvassent leurs nids, c'est-à-dire pour que les pauvres du Christ vécussent en paix sous votre ombrage, en priant pour vous [334-1]. »
pp. 334-335
Il ne reculait, en ce qui concernait sa personne, devant aucune des conséquences de ses doctrines, et il les manifestait, dans les termes suivants, au seigneur de son diocèse, Étienne, comte de Blois et de Chartres : « À quiconque osera envahir l'Église confiée à ma faiblesse, je saurai résister de toute la force que Dieu m'a donnée, jusques et y compris la ruine et l'exil, et je le frapperai du glaive spirituel jusqu'à ce que satisfaction ait été accordée. Or, ce glaive détruit les citadelles, renverse les murailles, et tout ce qui s'élève contre l'humilité du Christ, et tout ce qui envahit l'héritage acheté par son sang. C'est un glaive que la pauvreté retrempe, que l'exil ne saurait briser, que nulle prison ne saurait enchaîner [335-1]. »
Yves de Chartres ose faire des rerprésentations au Pape. pp. 335-336
Ainsi parlait aux princes de la terre cet évêque qui, fort de son dévouement à Dieu et à l'Église, se permettait, quand il y avait lieu, d'adresser des représentations aux papes eux-mêmes. Anselme et bien d'autres n'agissaient pas autrement, et on verra saint Bernard les dépasser tous en franchise et en courage. Dans ces heureux siècles et parmi ces grands cœurs, au sein des plus éclatantes splendeurs et des plus terribles dangers, la papauté trouvait mille champions, mais pas un seul courtisan. La lutte des deux puissances, au sein de la chrétienté, semble avoir été, à toutes les époques, la condition inséparable de la vitalité de la foi catholique. Elle n'a jamais été suspendue qu'aux rares moments où le pouvoir temporel se trouvait entre des mains tout à la fois puissantes et irréprochables, ou durant les époques malheureusement trop prolongées où l'affaissement de la foi et du zèle, chez les catholiques, préparait et consommait leur asservissement. Au temps dont nous parlons, cette lutte éclatait jusqu'au sein du nouveau royaume fondé autour du saint sépulcre par les croisés victorieux, royaume qui était, à vrai dire, la créalion directe du pontilicat romain et comme la conquête même de Dieu et de l'Église.
Ce que devinrent Jérusalem et les croisés après la mort de G. de Bouillon.
Godefroy de Bouillon venait de mourir après un an de règne [336-1], trop tôt pour le salut de sa nouvelle patrie chrétienne, et son frère, Baudouin Ier élu à sa place par les chevaliers et les prêtres, Baudouin, brave et généreux comme lui, était engagé dans une longue série de contestations avec le patriarche de Jérusalem Daimbert [336-2], au sujet des possessions anciennes et nouvelles de cette Église affranchie. Les intrigues et la jalousie de l'archidiacre Arnoul, candidat malheureux à la dignité dont les croisés avaient jugé plus digne le légat Daimbert, paraissent avoir beaucoup contribué à entretenir la funeste scission [336-3]. Baudouin finit même par expulser Daimbert de son siège, pour le remplacer par un certain Cremar, qui fut à son tour déposé comme intrus par jugement du légat Gibelin [336-4]. Mais ces discordes ne diminuaient en rien l'ardente foi ni le pieux dévouement qui armaient les croisés contre les forces sans cesse renaissantes de l'islamisme. Les musulmans d'Égypte, de Syrie, d'Arabie et de Perse se précipitaient tour à tour sur les nouveaux établissements des chrétiens, et leur faisaient essuyer les pertes les plus cruelles, les plus sanglanles défaites, sans pouvoir ébranler leur constance.
pp. 337-339
La prise de Jérusalem, quoique achetée si cher, ne servit qu'à surexciter les esprits dans tous les royaumes chrétiens [337-1]. Ce fut pendant les premières années du onzième siècle une croisade perpétuelle, un mouvement permanent des peuples de l'Occident vers l'Orient ; et, quoique la terre sainte fût devenue comme le vaste ossuaire des générations disparues, chaque année amenait sur ces plages de nouvelles armées de pèlerins avides de contempler les saints lieux, et de combattre dans les rangs de la poignée de héros qui, sous la conduite du roi Baudouin, des Normands Tancrède et Bohémond, du comte Raymond de Toulouse et de Baudouin du Bourg, défendaient leurs nouvelles seigneuries incessamment assaillies par les musulmans. En 1101, une flotte génoise aida le roi Baudouin à prendre d'assaut Césarée, et put rapporter en triomphe, comme principal trophée, le vase sacré où Notre-Seigneur avait consacré son sang dans la nuit de la Cène [337-2]. Mais ces triomphes n'étaient réservés qu'au très petit nombre. La plupart des croisés ne recueillaient qu'une mort glorieuse, assimilée par la foi des contemporains à celle des martyrs. Cent mille Lombards, sous la conduite de l'archevêque Anselme de Milan et de plusieurs seigneurs, se mirent en route à travers la Thrace et l'Asie mineure. L'archevêque portait devant eux un bras de son illustre prédécesseur saint Ambroise, bras sans cesse levé pour bénir les croisés. Ces pèlerins furent suivis et rejoints par une armée de chevaliers allemands, à la tête desquels figuraient le duc Welf de Bavière, l'archevêque Thiémon, de Salzbourg, et la margrave Ida d'Autriche, que sa beauté et la faiblesse de son sexe n'empêchèrent pas de s'exposer aux périls d'une expédition où elle devait trouver la mort [338-1]. Enfin une troisième armée se mit en route, composée de Français et dont faisaient partie le duc Guillaume d'Aquitaine, le comte de Poitou, le duc Eudes de Bourgogne, le comte de Nevers [338-2] et le comte Harpin de Berry, qui, pour subvenir aux frais de l'expédition, avait vendu jusqu'à son comté au roi Philippe. L'indignation publique contraignit les princes que les premiers malheurs de la croisade avaient éloignés de l'armée, à rejoindre leurs compagnons. Parmi ces guerriers figuraient Hugues de Vermandois, frère du roi, et Étienne de Blois que les reproches de sa femme Adèle, l'amie d'Anselme et la fille de Guillaume le Conquérant, avaient ramené en terre sainte. Ces trois grandes armées, où l'on comptait plus de cinq cent mille pèlerins [339-1], périrent presque en entier dans les défilés de l'Asie mineure, avant même d'avoir pu voir Jérusalem, par suite de l'odieuse perfidie des empereurs byzantins et aussi de la funeste influence du climat. Le duc de Bourgogne et le comte de Blois, qui purent arriver jusqu'en Palestine, trouvèrent la mort sur le champ de bataille de Ramla. Le duc Guillaume d'Aquitaine, le fier et brillant comte de Poitou, qui était parti à la tête de trente mille Poitevins armés de cuirasses, sans compter la foule de gens de pied, revint en Aquitaine presque seul de tous les siens [339-2].
pp. 339-341
Cependant, l'enthousiasme avait survécu. Après tant d'affreux revers, quand Bohémond, le prince d'Antioche échappé des prisons musulmanes après quatre ans de captivité, revint en France [340-1], il enflamma tous les cœurs par les récits de la croisade. En digne fils de Robert Guiscard [340-2], Bohémond avait pris le parti du patriarche Daimbert revenu à Rome avec lui. Pascal fit don au vaillant chevalier du gonfanon de Saint-Pierre, et lui associa, pour prêcher la croisade, l'évêque Bruno de Segni, l'ami et le légat de Grégoire VII, qui venait de se réfugier au Mont-Cassin [340-3], d'où le pape le retira pour accompagner Bohémond. Celui-ci se rendait en France pour accomplir le vœu qu'il avait fait, dans sa prison, de visiter en pèlerin le tombeau du moine saint Léonard, dans l'église de ce nom, en Limousin [340-4]. Le prince y fit l'offrande des chaînes d'argent dont les Turcs s'étaient servis pour le lier dans son cachot.
Bohémond, prince d'Antioche, épouse la fille de France et prêche la croisade à Notre-Dame de Chartres, en Espagne et en Italie.
Le roi Philippe accorda au héros sa fille Constance, et, à Chartres au milieu des fêtes du mariage, Bohémond monta dans une tribune dressée devant l'autel de Notre-Dame et, faisant appel aux guerriers qui l'entouraient, il leur inspira le désir de le suivre en Palestine, par le récit de ses aventures et la promesse de la gloire et des hautes destinées qui les y attendaient [341-1].
Concile de Poitiers où Bohémond d'Antioche et le moine Bruno prêchent la croisade.
De là, le prince alla à Poitiers, où le saint moine Bruno tint un concile au nom du pape [341-2], et où tous deux haranguèrent la nombreuse assemblée [341-3]. Loin que l'exemple des échecs subis et du funeste retour de Guillaume d'Aquitaine, c'est-à-dire du prince même dont Poitiers était la capitale, ait découragé l'auditoire, on vit au contraire les chevaliers du Limousin, de l'Auvergne et du Poitou se disputer l'honneur de s'associer au héros normand, et d'accompagner à Antioche le prince de cette cité [341-4]. Le nombre des guerriers qui se présentaient était si grand qu'on qualifia les levées de Bohémond, de troisième croisade [341-5].
pp. 341-342
Le prince voulut en outre aller lui-même faire appel à l'Espagne, où la guerre contre les infidèles avait précédé de trois siècles la première croisade et où le roi Alphonse VII de Castille, dit le Vailland, continuait contre les Almoravides une lutte glorieuse qu'il devait couronner par la prise de Cordoue [342-1] ( 1108 ).
pp. 342-343
Bohémond en ramena de nouveaux soldats de la croix et il en trouva d'autres en Italie, avec lesquels il entreprit de châtier la longue perfidie des schismatiques grecs à l'égard des Latins ; mais l'expédition échoua. Il en ressortit du moins un merveilleux témoignage de l'union de tous les peuples chrétiens sous la main des papes, dans cette grande et longue guerre contre les infidèles. Et, en effet, l'année même où mourut Bohémond, on vit une flotte norvégienne débarquer sur la plage de Syrie des auxiliaires inattendus, et Sigurd, le fils du roi Magnus, avec dix mille des siens, venir aider le roi de Jérusalem à conquérir Sidon ( 19 déc. 1111 ) [342-2], puis s'en retourner au fond de la Baltique sans autre récompense qu'un morceau de la vraie croix. Cependant le roi d'Aragon et de Navarre, Alphonse le Batailleur, entretenait toujours la croisade en Espagne et méritait son surnom par un grand nombre de combats livrés aux infidèles, et de victoires remportées sur eux. Les moines étaient, là comme partout, plus ou moins directement mêlés à l'action des peuples catholiques, et entretenaient dans les cloîtres ces foyers de vie spirituelle, où les rois et les chevaliers venaient se retremper, et puiser la force qui armait leurs bras et leurs cœurs.
Influence des moines de la Grande-Sauve sur la chevalerie d'Espagne. pp. 343-345
Nous avons raconté comment les moines de Cluny avaient été pour ainsi dire associés à la fondation des royaumes de Castille et d'Aragon, sous Sanche le Grand et sous Ramire Ier [343-1]. À la fin du onzième siècle, ces royaumes subirent la nouvelle influence de la congrégation de Notre-Dame de la Grande-Sauve, en Guienne, dont on a vu plus haut l'origine toute chevaleresque [343-2]. Sanche Ramire Ier, qui, comme son grand-père Sanche le Grand, réunit la Navarre à l'Aragon, franchit les Pyrénées et alla visiter, dans leur solitude, entre la Gironde et la Dordogne, ces preux sortis de leur terre natale pour venir exercer la chevalerie chrétienne au fond d'incultes forêts : frappé de la profonde pauvreté de ces serviteurs de Dieu [343-3], le prince espagnol leur accorda d'abondantes concessions de territoires dans son royaume et demanda qu'en échange de ces dons un pauvre fût nourri à perpétuité dans l'abbaye, comme représentant la personne du roi d'Aragon, dans le présent et dans l'avenir, avec la seule obligation pour les donataires de prier pour leur bienfaiteur [344-1]. Le prince leur donna de plus, par avance, toutes les dîmes du territoire d'Exea, avec ses mosquées à convertir en églises, lorsqu'il s'en serait rendu maître [344-2]. À la faveur de ces bienfaits, de nombreuses maisons dépendantes de la congrégation de la Sauve s'établirent en Espagne, et il y eut même un ordre spécial de chevaliers soumis à cette abbaye, qui se distinguèrent par leurs prouesses contre les infidèles [344-3]. Sanche fut tué d'un coup de flèche en faisant le siège d'Huesca [344-4] ; mais sa promesse fut exécutée par son fils Alphonse le Batailleur, qui dut son surnom au grand nombre de combats livrés par lui aux infidèles. Comme il assiégeait Exea, en 1107, et que le siège traînait en longueur, le comte de Bigorne et d'autres seigneurs gascons qui lui servaient d'auxiliaires lui rappelèrent la parole de son père, et lui conseillèrent de s'engager, devant Dieu, la sainte Vierge et saint Gérard, le fondateur de la Grande-Sauve, à remplir les intentions du roi défunt. Don Alphonse fit le serment demandé : le lendemain, toute l'armée se confessa, puis, s'étant recommandée à saint Gérard, courut à l'assaut. La ville fut prise, et Alphonse y fonda aussitôt une abbaye qui fut longtemps célèbre en Espagne. Le prince se rendit ensuite, accompagné de toute la noblesse de Gascogne, au monastère de la Sauve, où de solennelles actions de grâce furent rendues à Notre-Dame et à saint-Gérard [345-1].
Notes chapitre VII
[317-1]. Quidam Belgicæ provinciæ episcopi… tanquam mortuo præcone justitiæ, justitiam mortuam esse crediderunt. Ivon., Carnot. Ep. 84.
[317-2]. Quia si intra Belgicam vel Celticam celebraretur mulla premi silentio oporteret… quæ ventilata scandalum generarent… pressa vero silentio tanquam verbo Dei alligato, legationis tuæ auctoritati plurimum derogarent. Ibid.
[318-1]. Il y en avait quatre-vingts, suivant Hugues de Flavigny, et cent quarante selon Gauffridus Grossus, Vit. Bernardi Tironensis.
[318-2]. Velocius direxerat hortans et contestans ne hoc fieri permitteret in urbe sua, quæ de ipsius regno erat. Append. ad VU. B. Hilarii, Script, ver. Gallic. t. XIV, p. 108. Fleury et les bénédictins désignent ce prince sous le titre de Guillaume VII comme comte de Poitiers, sous celui de Guillaume IX, comme duc d'Aquitaine. Il fut père de Guillaume X, dernier duc d'Aquitaine, dont la fille Éléonore porta cet héritage successivement à Louis VII et à Henri II. Il était célèbre par son esprit caustique, son talent poétique et son amour désordonné des femmes. V. Guill. de Malmesbury, l. V, p. 170.
[318-3]. Totius pudicitiæ et sanctitatis inimicus, timens ne similem vindictam pro criminibus actis pateretur, Gauff. Geoss., Vit. Benn. Tir., l. C. Il faut dire que tous les contemporains ne le traitaient pas si sévèrement : l'abbé Geoffroy de Vendôme le loue ouvertement, et Mabillon doute de tous les excès qu'on lui impute. Ann. Bened., l. LXIX, n. 157.
[319-1]. Ibi vigiliis et orationibus sedulus instabat, donec media fere nocte ad hospitium remearet… Nocte vero illa prolixius et propensius cum lacrymis orabat… cum in medio precum suarum obdormire cœpisset… Ne timeas, carissime frater… quoniam in concilio cras ero tecum….
[319-2]. Nimio furore succensus, jussit omnes illos depredari, flagellari, occidi. Gauf. Gross., l. c. Cum primam causam legunt…. advenit tanquam furibundus, magna caterva stipatus suorum…. mullumque vociferans, in hæc verba prorupit… Ser. rer. Franc. t. XIV, p. 108.
[319-3]. Ad dedecus ipsius et meum in hac urbe quam ab ipso habeo. Ibid.
[319-4]. Fleury, l. LXV. II. 8.
[320-1]. Cum episcopis et abbatibus de proprietate regis. Ser. rer. Franc., l. c.
[320-2]. Pontifices et abbates omnes hæc illucque diffugiunt. Gauf. Gross., l. c.
[320-3]. Immobiles constantesque perstiterunt. Ibid.
[320-4]. Fleury, l. LXV, c. 10.
[320-5]. Si dominus comes iste sui regis, utique terreni, mandata… Paveant igitur et fugiant mercenarii ad adventum lupi, maneant hic nobiscum qui sunt boni et veri pastores… Ibid.
[321-1]. Conversus ad comitem, voce clara ait : B. Joannes… et ego non refugio me propter hoc decollari, si volueris ; et extendens collum : Percute, inquit, si audes, quia præsto sum… Ibid.
[321-2]. Ocius concilium exit, ne regem audiret excommunicari. Ibid.
[321-3]. Habemus nobiscum in hoc conflictu præsentem et socium B. Hilarium… sicut ipse mihi dixit hesterna nocte. Ibid.
[322-1]. Manent columnæ Christi immobiles, mortem intrepidi aperientes, et ad saxa volantia, mitris ablatis, capita nuda retegentes. Hugo Flavin. Chron. Virdun., Scr. ver. Franc., t. XIII, p. 626.
[322-2]. Prostratus in terra coram cardinalibus, culpam confitebatur et veniam postulabat… se talia non commissurum cum juramento pollicitur. Append. ad Vit. S. Hilar., l. C.
[323-1]. Fleury, l. I.XY, c. 28.
[323-2]. Cavete et nobis et vobis ut semper clavibus et catenis Petri fortiter teneatur. Ivon., Epist. CIV.
[324-1]. Si forte absolutus fuerit, et ad vomitum reversus…. e vestigio eisdem clavibus recludatur, eisdem catenis religetur. Ibid.
[324-2]. Voluntate regis et illius contubernalis suæ. IV. Ep. 87.
[324-3]. Ep. 87, 89, 94, 95. On voit qu'Yves, tout en combattant l'élection d'Étienne de Garlande, avait eu la faiblesse de lui accorder une lettre de recommandation pour le pape, lettre assez équivoque, mais que le pape lui reprocha avec raison.
[324-4]. Consilio optimatum diœcesis suæ et laude populi. Ep. 104. — Quemdam religiosum. Ep. 89.
[325-1]. En rapprochant les deux ép. 105 et 144 d'Yves, on voit que le même serment fut fait par les deux rois.
[325-2]. Ep. 105.
[325-3]. Ut ostenderet quia apud eum mundi sapientia vel secularis potentia nullius sunt momenti. Ep. 102.
[325-4]. Ep. III, 69.
[326-1]. Baron., ann. 1104, c. — Pagi, Crit. in enmd.
[326-2]. Suggerendo dicimus non ducendo…. ut imbecillitati hominis, amodo, quantum cum salute ejus potestis, condescendatis, et terram quæ ejus anathemate periclitatur, ab hoc periculo eruatis. Ep. 144.
[327-1]. Advenit rex satis devote et multum humiliter, nudis pedibus… Peccatum et consuetudinem carnalis et illicite copulæ quam hactenus cum Bertrada exercui… penitus et sine retractatione abjuro… In præsentia honorabilium clericorum et laicorum non parva multitudine inibi consistentium… Taliter reincorporatus est rex Francorum S. catholicæ Ecclesiæ matris suæ. Ms. Igniacens. et Ms. Corbeiens. ap. Labbe. Concil., tom. X, 668 et 742. — Cf. Pagi, Critic, in 1104.
[327-2]. Voir la collection de ses épîtres, au nombre de deux cent quatre-vingt-sept, remises dans un ordre nouveau et publiées avec des notes, par Judet, chanoine de Langres, et Souchet, chanoine de Chartres. In-fol. Paris, 1647.
[327-3]. Ep. 247, 252 et passim.
[327-4]. Ep. 70, 110 et passim.
[327-5]. Ep. 154, 100, 183, 221, 242, 243, etc.
[328-1]. Paschali, summo pontifici, Ivo humilis Carnotensis minister, sicut auctoritate ita præeminere virtute. Ep. 109.
[328-2]. Quoniam uterinum filium Romanæ Ecclesiæ, testante conscientia mea me esse cognosco, cum scandalizatur non possum non uri, cum tribulatur, tribulor, cum detractorum livido dente laceratur, disrumpor. Ep. 89.
[328-3]. Ep. 109.
[328-4]. Super quam et impunitam appellatorum licentiam. Ep. 219. Le cardinal Baronius répond à ce reproche avec justesse : « Aditus iste non potest nec debet ita occludi malis, ut non pateat bonis adversus malos. » Ann. 1104, c. 12.
[328-5]. Litteras a sede apostolica nescio quibus subreptionibus impetratas nobis deferunt ad pallendam malitiam suam vel defendendam inobedientiam… Ab ipsis columnis gratanter audiuntur cum vitam religiosorum aliquibus maculis respergere moliuntur. Ep. 110.
[329-1]. Cubicularios et ministros sacri palatii… cum nec calamus nec charta gratis ibi ( ut aiunt ) habeatur. Ep. 153.
[329-2]. Matth., XXIII, 3.
[329-3]. Si qua pudenda patris, quod Deus avertat, revelata fuerint… quia multos amatores justitiæ jam vidi propter remissa flagitiis… ori silentium posuisse et a spe corrigendorum malorum plurimum defecisse. Ep. 89. On ne voit pas que le pape se soit jamais irrité de la rude franchise de ce langage, et le cardinal Baronius, cet ardent défenseur des droits de la papauté, dit en citant cette lettre même : Has litteras dedit, tanto viro dignas, et cui scriberentur valde utiles. » Ann. 1101, c. 10.
[330-1] Voir plus haut.
[330-2]. Hugues, vicomte du Puiset.
[330-3]. Nolo quemquam more sicariorum sine audientia punire… Ep. 169. Rotrou trancha la question en en appelant directement au saint-siége.
[331-1]. Si aliqua dispensatione faciente cogerer aliquem impœnitentem ad reconciliationem admittere… Nolo te fallere : introitum hujus visibilis Ecclesiæ cum tuo periculo te habere permitto, sed januam regni cœlestis tali reconcilialione tibi aperire non valeo. Ep. 171.
[331-2]. Tempore beatæ memoriæ papæ Gregorii. Epist. 24.
[331-3]. Epist. 236 et passim.
[331-4]. De investituris Ecclesiarum quas laici faciunt sententiam præcedentium patrum Greg. VII et Urb. II, quantum in me est, laudo, confirmo. Quocumque autem nomine talis persuasio proprie vocetur, eorum sententiam, qui investituras laicorum defendere volunt, schismaticam judico. Ep. 235.
[332-1]. Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur mundus, floret et fructificat Ecclesia : cum vero inter se discordant, non tantum parvæ res non crescunt, sed etiam magnæ res miserabiliter dilabuntur. Ep. 258.
Ce passage a été pris par l'illustre archevêque de Cologne, Clément de Droste, pour épigraphe du livre où, captif et exilé pour la foi, la liberté de l'Église et la sainteté du mariage, il a si sagement établi les limites des deux puissances. C'est ainsi qu'au sein de la vérité catholique s'unissent, à travers les siècles, les âmes des grands évêques pour la défense de leur mère commune.
[332-2]. Habeat ergo Deus in Ecclesia sua principaliter quod suum est. Habeat rex, posteriori ordine post Deum quod sibi a Deo concessum est. Ep. 102.
[333-1]. In mente habere debes quia… et Illius es liber qui pro te se servum fecit, ut libertas tua nihil se debere intelligat alicui quo divinam offendat majestatem, et Ecclesiæ minuat libertatem… Non ad hoc instituuntur reges, ut leges frangant. Ep. 154.
[334-1]. Sicut enim sensus animalis subditus debet esse rationi, ita potestas terrena subdita esse debet ecclesiastico regimini. Et quantum valet corpus, nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas nisi… Et sicut pacatum est regnum corporis… Servum servorum Dei vos esse intelligite, non dominum… unam debet esse de cedris Libani quas plantavit Dominus, in qua nidificent passeres, etc…. Ep. 106. — Lettre bien digne, disait Baronius en la citant, en 1607, d'être lue et relue à tous les rois, surtout de nos jours où l'exécrable hérésie des politiques, sous le voile des droits de l'État, pénètre dans le cabinet des rois et s'y met à l'abri de leur gloire. Ann. 1100, c. 39.
[335-1]. Quos terminos cuicumque præsumpserit adversus Ecclesiam parvitati meæ commissam transcendere… Hic gladius penetrat turres, dejicit propugnacula, et omnem allitudinem…. hic gladius in egestate fortior est, in exilio non frangitur, carcere non alligatur, etc. Ep. 49.
[336-1]. 18 juillet 1100.
[336-2]. Ou Théobert, archevêque de Pise, envoyé légat auprès de l'armée croisée par Urbain II, en remplacement d'Adhémar, évêque du Puy, mort à Antioche.
[336-3]. On peut voir le détail de cette lutte dans Guillaume de Tyr ( lib. X, c. 14 ; XI, c. 1 et seq. ; XII, c. 20 ap. Gesta Dei per Francos ) et comparer ce récit avec celui d'Albert d'Aix dans le même recueil. Albert est défavorable au patriarche.
[336-4]. Guill,. Tyr., XI, c. 4.
[337-1]. Mox profectio populosa et quæ pene priori posset numero duntaxat æquari, subsequitur. Chron. Ursperg.
[337-2]. Il sacro calino, transporté à Paris sous l'empire, et restitué aux Génois en 1815. Caffari ann. Genuens. ap. Murator., Script. rer. Italic., t. VI, p. 248.
[338-1]. Lüden, Geschichte des Deutschen, etc., t. IX, p. 289. — Eckhard. abbat., libell. in ampl. Coll., t. V, p. 507. — Alb. Aquen, in Gesta Dei per Francos.
[338-2]. Guillaume II, le même qui fut déposé par saint Bernard comme régent du royaume avec Suger, lors de la seconde croisade. Il avait rassemblé, à lui seul, 15000 hommes à Nevers, et avait reçu, avant de partir, la bénédiction de saint Robert, abbé de Molesmes, au prieuré de Saint-Étienne de Nevers. Crosnier, Tableau chronol. et synopt. du Nivernais et du Donziais.
[339-1]. Præter vulgus, ad triginta millia loricatorum. Chron. Ursperg.
[339-2]. Præter vulgus, ad triginta millia loricatis. Chron. Ursperg. — — Annal. Sax. ad 1102. — Ord. Vit. — Selon une autre version, il conduisait 180000 combattants. — Conc. Coletti, t. XII, p. 1223.
[340-1]. En mars 1106, Orderic Vital, XI, 816. Cet écrivain attribue sa délivrance à l'amour qu'il avait su inspirer à la fille de l'émir dont il était prisonnier.
[340-2]. Daimbert lui écrivait : Tu autem, nisi paternæ gloriæ vis esse degener filius, qui tyrannica crudelitate clausum ab impia manu dominum apostolicum Gregorium de urbe Roma cripuit, unde memorabile oculis omnibus nomen meruit. Guill. Tyr., l. X, c. 14.
[340-3]. Petr. Diaco, Chron. Cassin., l. IV, c. 33.
[340-4]. Cette église monastique, qui a donné naissance à la pelile ville de Saint-Léonard, subsiste encore : elle est, dans sa forme actuelle, à peu près contemporaine de Bohémond ; on peut en voir une représentation assez exacte dans l'Ancien Limousin,de M. Tripon, t. I.
[341-1]. Chron. Malleac., ann. 1106. — Cf. Fleury, l. 65, n. 48.
[341-2]. 20 juin 1106.
[341-3]. Plenum et celebre concilium, dit l'abbé Suger, qui y assista lui-même. Vit. Lud. Crass., c. 9.
[341-4]. Michaud, Hist. des Croisades, t. II, p. 47, ed. 1825.
[341-5]. Tunc tertia profectio occidentalium in Jerusalem facta est, multorumque maxima conglobatio millium pedibus suis Byzanteum stemma conculcare, p. 478, tantum contra Turcos progressa est. Ord. Vit., 589.
[342-1]. Guill. Tyr. l. XI, c. 14. — Torf, Hist. ver. Norvegicar., pars III, c. 18.
[342-2]. Il régna de 1104 à 1154 ; sa capitale était Saragosse.
[343-1]. Voir ci-dessus.
[343-2]. Ibid.
[343-3]… Qui de patria progressi in silva majori, dignam Deo exercebant militiam… cum postea ad eos gratia visendi venissem, corum quo nimiam cognovissem potestatem, etc. Diplôme du roi Sanche, in Act. SS. O. B., t. IX, p. 846, ad ann. 1095.
[344-1]. Quatenus pro rege Sancto et pro unoquoque de successione ipsius pauper unus… accipiatur ut monachus, fiat omnino sine pecunia, loco regis vestiatur, manducet et bibat.
[344-2]. Cirot, Hist. de la Grande-Sauve, t. I, p. 348.
[344-3]. Ibid.
[344-4]. En 1054.
[345-1]. V. Cirot, Hist. de la Grande-Sauve, t. I, pp. 457 et 525. — Cf. Marten., Thesaur. Anecdot., 1, 263, et D. Bouquet, Hist. de Fr., t. XII, p. 384.
⁂